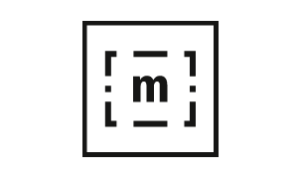Le musée Masséna, joyau architectural de la Promenade des anglais, évoque, au travers de ses collections, l’art et l’histoire de la Riviera à compter du rattachement de Nice à la France jusqu’à la fin de la Belle Époque.
L’ensemble des œuvres évoque ce thème par une scénographie qui allie les arts graphiques, le mobilier et les objets de cette période et plus particulièrement l’histoire.
Sont entre autres présentés le masque mortuaire de Napoléon réalisé par le Docteur Arnolt, le diadème de Joséphine en nacre, or, perles et pierres de couleur offert par Murat à l’Impératrice et le livre écrit par le Préfet Liegeard.
Le visiteur pourra aller à la rencontre des peintres paysagistes du XIXe siècle et plus particulièrement Joseph Fricero, Antoine Trachel ou Alexis Mossa…
Il est à noter que le rez-de-chaussée de la Villa est en lui-même une œuvre grâce à son somptueux décor intérieur créé par les architectes Hans-Georg Tersling et Aaron Messiah, et le mobilier et les objets d’art du 1er Empire qui garnissent les salons.
La Villa Masséna a été édifiée sur la Promenade des Anglais, entre 1898 et 1901 par l’architecte danois Hans-Georg Tersling (1857-1920), l’un des meilleurs architectes de la Côte d’Azur à la Belle Époque. Le style choisi est néo-classique avec une forte empreinte italianisante.
Le prince Victor d’Essling (1836-1910) petit-fils du Niçois André Masséna, en fait sa résidence d’hiver. Son fils, André, héritier du domaine à la mort de son père, en fait don à la Ville de Nice en 1919, et le musée Masséna est inauguré en 1921.
Une vaste campagne de rénovation, menée par la ville de Nice entre 1999 et 2008, a permis de restaurer la villa de la Belle-Époque, ses décors intérieurs, et de valoriser ses collections historiques et artistiques..
Le musée bénéficie d’un jardin historique aménagé selon le dessein d’un architecte paysagiste révolutionnaire à la fin du XIXème siècle et le début du XXème, à savoir, Édouard André donnant sur la promenade des Anglais et attenant au fameux hôtel Negresco.
Le Maréchal André Masséna
André Masséna est né à Nice le 6 mai 1758. Fils d’un marchand de vin, il s’engage en 1775 dans un régiment français dont son oncle est sergent recruteur.
En 1789, il épouse Rosalie Lamarre, fille d’un chirurgien antibois. Il devient capitaine instructeur de la Garde nationale d’Antibes, puis lieutenant colonel du 2ème bataillon des volontaires nationaux du Var et participe, à ce titre, à l’invasion du Comté de Nice en 1792.
L’année suivante, il est général de brigade puis de division. Connaissant bien la région, il joue un rôle décisif dans la conquête du haut pays niçois, en particulier dans la Haute-Roya. Adjoint de Bonaparte, son rôle est essentiel dans l’Armée d’Italie et il se distingue particulièrement aux batailles de Lodi, Rivoli et la Favorite (1796). Commandant de l’Armée d’Helvétie, du Danube et du Rhin (1799), il remporte la victoire de Zurich. Chargé ensuite par Bonaparte de commander l’Armée d’Italie, il doit capituler à Gênes, mais dans les meilleures conditions possibles. En 1804, Napoléon élève au grade de maréchal celui qu’il qualifiera « l’enfant chéri de la victoire ».
1809 marque le sommet de sa carrière militaire. Il joue un rôle décisif à Essling et à Wagram. Nommé commandant de la division militaire de Marseille et commandant de la Garde nationale de Paris, après Waterloo, il est relevé de son commandement au retour du roi. Il meurt le 4 avril 1817 à Paris.
Si Masséna ne reviendra que deux fois à Nice, après la fin des campagnes d’Italie, sa sollicitude se manifestera toujours envers sa ville natale, dont il se fera le protecteur attitré auprès de l’administration. Quand le maréchal est titré prince d’Essling en 1810, le conseil municipal de la ville de Nice décide de commander son portrait, peint l’année suivante par Louis Hersent (1777-1860) celui-ci est exposé dans la grande galerie.
La révolution et l’empire
Lors des premiers événements de la Révolution françaises, de nombreux émigrés français trouvent refuge à Nice, car la ville fait partie des Etats du roi de Sardaigne.
Le Var, frontière avec la France, est franchi le 28 septembre 1792 par les troupes révolutionnaires qui prennent la ville le lendemain sans résistance, car elle a perdu son rôle militaire avec la destruction du château et des remparts sur ordre de Louis XIV en 1706. Le 31 janvier 1793, la Convention proclame la réunion à la France.
Le 4 février 1793, le département des Alpes-Maritimes est créé avec Nice comme chef-lieu.
Bonaparte effectue trois séjours à Nice. Il y organise l’Armée d’Italie.
Après la période révolutionnaire, très néfaste pour l’économie locale, le préfet Gratet du Bouchage (1746-1829), nommé par Napoléon, contribue à l’essor du département. L’absence des touristes britanniques, qui viennent séjourner en hiver depuis le milieu du XVIIIème siècle, est une cause d’appauvrissement.
Pour des raisons stratégiques, on ouvre la Grande Corniche, première route carrossable longeant la mer vers l’Italie.
L’impératrice Joséphine (1763-1814) contribue avec succès à l’acclimatation de plantes exotiques.
Pauline Borghèse (1780-1825), sœur de Napoléon, séjourne à deux reprises à Nice.
Le Traité de Paris du 30 mai 1814 met fin à l’occupation française.
La restauration sarde
En 1388, Nice et sa région – appelée Comté de Nice à partir du XVIème siècle – se séparent de la Provence pour appartenir à la Maison de Savoie qui règne également sur le Piémont.
En 1720, les ducs de Savoie deviennent rois de Sardaigne. Victor-Emmanuel 1er (1759-1824) monte sur le trône en 1802 mais il ne règne qu’en Sardaigne en raison de l’occupation de ses autres territoires par les Français. Il les récupère en 1814 et obtient de surcroît l’ancienne République de Gênes. Les institutions d’Ancien Régime comme le Sénat, sont rétablies. L’Eglise joue un rôle primordial. La politique réactionnaire du roi entraîne, en 1821, une révolte à Turin, rapidement matée après l’abdication de Victor-Emmanuel 1er. Son frère, Charles-Félix (1765-1831), lui aussi très catholique et opposé à l’unité italienne, lui succède. Il est très populaire à Nice où il séjourne longuement à deux reprises avec la reine Marie-Christine (1779-1849), en 1826-1827 et 1829-1830. La mort de Charles-Félix (1831) marque la fin de la branche aînée des Savoie. La couronne passe aux Savoie-Carignan en la personne de Charles-Albert (1798-1849). Après s’être aligné sur les idées politiques de ses deux prédécesseurs, il se rallie au libéralisme et promulgue le Statuto (1848) qui fait du Royaume de Sardaigne une monarchie parlementaire. Son engagement en faveur de l’unité italienne l’entraîne à entrer en guerre contre l’Autriche. Battu à Novare (23 mars 1849), il abdique. Son fils, Victor-Emmanuel II (1820-1878) poursuivra la même politique et deviendra le premier roi d’Italie (1861).
Du second empire à la belle époque (1860-1914)
Conscients de ne pouvoir chasser les Autrichiens du nord de l’Italie sans un allié puissant, Victor-Emmanuel II et son ministre Cavour se tournent vers Napoléon III. En contrepartie de son aide militaire, la France recevra la Savoie et la province de Nice avec l’accord des populations concernées. La ville est divisée entre les partisans de la France et ceux de l’Italie menés par Garibaldi. Des raisons économiques et le soutien de l’Eglise expliquent le ralliement de la majorité des Niçois au rattachement à la France mais le résultat du plébiscite à Nice (6810 oui et 11 non sur 7918 inscrits), minore l’importance de l’opposition.
Le 11 juin 1860, l’annexion est officielle et le lendemain, le département des Alpes-Maritimes est créé par l’union de la province de Nice (Nice devient préfecture, Puget-Théniers sous-préfecture) et de l’arrondissement de Grasse détaché du département du Var. Napoléon III et Eugénie viennent en voyage officiel dès 1860.
Syndic de Nice depuis 1856, François Malausséna (1814-1882) est le premier maire de la période française, jusqu’à la chute du Second Empire en 1870.
Lui succèdent Auguste Raynaud (1871 à 1878), Alfred Borriglione (1878 à 1886), Jules Gilly (1886), Frédéric Alziary de Malaussène (1886 à 1896), Honoré Sauvan (1896 – 1912 puis 1919-1922), François Goiran (1912-1919).
De la vieille ville à la cité balnéaire
Au début du XIXème siècle, la commune de Nice compte 25 000 habitants, la moitié demeurant dans la ville (l’actuel Vieux-Nice), le reste étant disséminé dans la campagne.
Si le XIXème siècle est une période de développement urbain généralisé basé sur les activités industrielles et commerciales, Nice doit quant à elle son expansion essentiellement au tourisme.
Durant la première moitié du XIXème siècle, la ville se développe à proximité du port, le long de la rive droite du Paillon, en face de la Vieille Ville et le long de la route de France. Afin de relier ce dernier quartier à la ville, on construit le Pont Neuf (1824) et l’on aménage la partie sud de la Place Masséna, puis, de 1845 à 1860, sa partie nord.
De 1832 à 1860, l’action du « Consiglio d’Ornato » (Conseil d’Ornement), commission dont l’approbation est indispensable pour toute création de nouvelles façades, donne une remarquable unité architecturale aux places et rues nouvelles.
De 1864 – date de l’arrivée du chemin de fer – à 1914, le développement sera beaucoup plus considérable. La population passe de 48000 à près de 150 000 habitants.
Le centre ville s’étend peu à peu dans la plaine de Longchamp, de part et d’autre de l’actuelle avenue Jean Médecin, construite entre 1860 et 1880. Il s’agit de quartiers bourgeois tandis que la population plus modeste (en particulier les très nombreux immigrés italiens) s’installe dans la vallée du Paillon, derrière le port. Les villas se multiplient sur les collines proches (Carabacel, Mont-Boron, Cimiez, les Baumettes, Fabron). Mais la plus grande partie du territoire communal est encore le domaine de la campagne où fermes et « maisons des champs » des familles nobles niçoises côtoient les nouvelles villas des riches hivernants.
Simple chemin en terre dû à l’initiative de la communauté britannique (1822), la Promenade des Anglais est aménagée par la ville à partir de 1844 et remplace rapidement le Cours Saleya comme centre de la vie mondaine.
Nice au quotidien
Nice est une ville maritime par ses activités portuaires et par la pêche. Sardines et anchois sont les prises principales des pêcheurs qui tirent leurs barques et remisent leurs filets sur les plages des Ponchettes en bordure du Vieux Nice, et celle de Carras.
Durant l’hiver, les collines sont le domaine des troupeaux descendus de la zone montagneuse, notamment des ovins.
Les cultures vivrières ont pour domaine essentiel le quartier Longchamp mais le développement urbain va transférer cette activité agricole vers la plaine du Var à partir du milieu du XIXème siècle. La principale richesse vient de l’olivier. Des moulins à eau donnent une huile de qualité très recherchée. Mais son importance économique décroîtra tandis que les cultures florales, au contraire, verront leur production augmenter considérablement grâce au canal de la Vésubie (1884) qui permet une irrigation à grande échelle et à l’amélioration des conditions de transport dans toute l’Europe.
A partir de 1820, la marqueterie produit des meubles et des objets de qualité, très recherchés comme souvenirs par les touristes. On grave et on peint des cougourdons (courges).
Chaque quartier rural a sa fête, appelée « festin » et les pêcheurs se réunissent aux Ponchettes pour la Saint-Pierre.
La population est particulièrement attachée aux fêtes religieuses et à ses traditions. Les confréries de Pénitents, composées de laïcs, restent très vivantes alors qu’elles ont tendance à disparaître durant le XIXème siècle dans le reste du midi de la France.
Le niçois, une branche de la langue d’oc, dont l’usage est généralisé, connaît une renaissance littéraire initiée par Joseph Rosalinde Rancher (1785-1843).
D’abord limitée au Comté de Nice, l’immigration devient essentiellement transalpine à partir des années 1870. Les Italiens sont particulièrement nombreux dans les métiers du bâtiment.
Lieux de mondanité
Nice s’affirme comme la ville la plus importante de la Riviera, cette bande côtière qui s’étend de Hyères à Gênes et qui connaît, chaque hiver, un afflux de touristes dont le nombre va décupler après l’arrivée du chemin de fer en 1864. Peu à peu, le terme de « Côte d’Azur », titre d’un ouvrage de Stephen Liégeard paru en 1887, va supplanter celui de Riviera pour sa partie française.
Certains hivernants viennent chaque année : on les surnomme les « hirondelles d’hiver ». Beaucoup font construire une « villa montée » dans un vaste jardin où se mêlent essences locales et exotiques. Elles sont caractérisées par leur grande variété de styles : néo-classique, mauresque, néo-gothique.
Les premiers grands hôtels sont construits, à partir des années 1840, le long du Paillon, en face de la vieille ville, en bordure du jardin public. Le Grand Hôtel (1867) est le premier à refléter le luxe de ceux de Londres et de Paris.
A partir des années 1860, les principaux hôtels sont construits le long du bord de mer et, à la fin du XIXème siècle, les collines, en particulier celle de Cimiez, voient se dresser d’immenses bâtiments – Hôtel Régina, Hôtel Impérial – aux façades orientées vers la mer.
Peu avant la première guerre mondiale, de prestigieux palaces – le Ruhl, le Négresco – offrent le confort moderne (une salle de bains par chambre, le chauffage central) et ponctuent la Promenade des Anglais de leurs coupoles d’angle.
La promenade est la grande occupation des hivernants. Vers 1860, la Promenade des Anglais supplante les terrasses en bordure du Vieux-Nice.
Avec la voiture automobile, on part à la découverte du haut pays niçois.
Nice, salon du monde
A partir du milieu du XVIIIème siècle, de nombreux Britanniques viennent séjourner l’hiver à Nice. De 1792 à 1814, le rattachement à la France révolutionnaire et napoléonienne les écartera momentanément de la Riviera française, mais ils reviendront au retour du roi de Sardaigne, en 1814. Ils seront assez nombreux, vers 1830, pour que l’on appelle le quartier autour de l’église anglicane « le Newborough » ou « la Petite Londres ».
Si leur pourcentage va en diminuant, ils resteront toujours, de loin, les étrangers les plus nombreux et les séjours de la reine Victoria (1819-1901) à Cimiez donneront un lustre inégalé à la renommée de la ville de Nice en Europe.
A partir des années 1840, les Russes sont nombreux à prendre le chemin de Nice, surtout après le séjour des tsarines et du Tsarewitch Nicolas (1844-1865). Mais, ce sont bientôt tous les peuples qui font de la ville de Nice le Salon du Monde, de novembre à mai.
Ainsi, la grande bourgeoisie américaine est suffisamment importante pour faire construire une église épiscopalienne en 1887 (actuel temple réformé). L’église luthérienne reçoit Allemands, Suédois, Norvégiens, Danois. Au début du XXème siècle, l’église orthodoxe de la rue Longchamp s’avère trop petite devant l’afflux des Russes et l’on doit construire une cathédrale (1912) considérée comme l’une des plus importantes hors de Russie. Aristocraties étrangère et niçoise fréquentent les mêmes salons et se retrouvent au sein du Comité des Fêtes.
Fêtes et divertissement
La saison d’hiver est une suite ininterrompue de réceptions, de concerts et de fêtes dans les grandes villas privées.
De nombreuses salles de spectacles existent dans la ville. Les cercles drainent une clientèle choisie car l’on doit être parrainé pour en faire partie contrairement aux casinos. Le premier casino est ouvert en 1867 sur la Promenade des Anglais mais il ne connaît qu’une existence éphémère, remplacé par le Cercle de la Méditerranée. Le Casino Municipal (1884) et le Casino de la Jetée (1891) connaîtront, eux, un succès durable, le second devenant même le bâtiment le plus emblématique de la Belle Epoque à Nice.
Janvier et février marquent le sommet de la saison d’hiver avec les courses et le Carnaval. S’il est mentionné à Nice dès le XIIIème siècle, c’est à partir de 1873, correspondant à la création du Comité des Fêtes, qu’il prend sa forme actuelle avec un défilé de chars burlesques en carton-pâte, des bals masqués et costumés (Veglione, Redoute) et des batailles de fleurs (1876) où les élégantes parent leurs voitures de motifs floraux.
Les régates, et à partir du début du XXème siècle, les courses automobiles et les meetings d’aviation attirent aussi un large public.
Les sports individuels se développent également (tennis, patinage, golf, etc….) essentiellement à l’initiative des Anglais et les Niçois commencent à se passionner pour les sports collectifs comme le football. La pratique du ski apparaît dans le haut pays de plus en plus visité grâce à l’augmentation du nombre d’automobiles.
Informations sur le régime fiscal du mécénat d’entreprise
Le régime fiscal du mécénat d’entreprise
Informations tirées du site mecenat.culture.gouv.fr
Lorsqu’une entreprise assujettie à l’impôt en France fait un don à un organisme d’intérêt général, elle bénéficie d’une réduction de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, mais peut aussi bénéficier de certaines contreparties en communication et relations publiques.
Pour les entreprises, la réduction d’impôt est égale à 60 % du montant du don effectué en numéraire, en compétence ou en nature, et retenu dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires H.T., avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. Il est à noter que les mécènes sont soumis à des obligations déclaratives.
Les contreparties
Les contreparties constituent un avantage offert par le bénéficiaire au donateur en plus de la réduction d’impôt. La valeur de ces contreparties doit demeurer dans une « disproportion marquée » avec le montant du don : il est communément admis un rapport de 1 à 4 entre les montants des contreparties et celui du don, c’est à dire que la valeur des contreparties accordées à l’entreprise mécène ne doit pas dépasser 25% du montant du don.
Exemple : une entreprise qui fait un don de 10 000 €, pourra bénéficier de contreparties à hauteur de 2 500 € ; si elle donne 100 000 €, les contreparties seront de 25 000 €. Il pourra s’agir de la présence du logo ou du nom de l’entreprise dans la communication de l’opération mécénée, d’entrées gratuites, de remise de catalogues, de mise à disposition d’espaces, etc…
Des avantages supplémentaires pour la culture
Des mesures spécifiques, très incitatives, ont été prises en faveur l’art contemporain, du patrimoine, de la pratique musicale, du spectacle vivant, de la sauvegarde et de l’enrichissement des collections publiques.
Par exemple, le financement par une entreprise de l’acquisition d’un bien culturel reconnu « trésor national » ou « œuvre d’intérêt patrimonial majeur » au profit d’une collection publique ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 90% du montant du versement effectué, dans la limite de 50% de l’impôt dû). Si l’entreprise acquière un « trésor national » pour son propre compte, l’avantage fiscal est de 40% des sommes consacrées à l’acquisition.
En savoir plus : Mettez votre entreprise sur le devant de la scène !
Nos mécènes
Stavros Niarchos Foundation – Grants
Dans le cadre de la rénovation de la villa Masséna, un vaste chantier de restauration des œuvres d’art de ses collections a été entrepris.
Un appel au mécénat s’est orienté sur la restauration d’un ensemble le plus significatif des collections par sa quantité et sa qualité égale aux grandes collections publiques : les bronzes et luminaires d’ameublement d’époque 1er Empire.
La Stravos S. Niarchos Foundation a généreusement contribué, par ce mécénat, à redonner à la villa du Prince d’Essling tout son éclat d’origine.
Le site de la fondation : snf.org
- Nice Historique est devenue la revue locale de référence sur l’histoire de Nice.
- Le Pays de Nice et ses Peintres au XIXe siècle.
- Bibliothèque de Cessole : Accès au fond numérisé
Le mémorial des victimes du 14 juillet 2016 est situé dans le jardin de la Villa Masséna dénommé « Jardin de la Légion d’Honneur ».