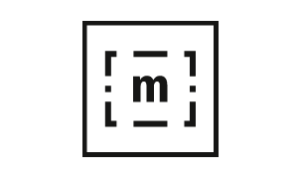Situé au cœur de la vieille ville, il est le monument le plus remarquable du baroque civil niçois par son escalier monumental orné de fresques et ses salons luxueusement décorés.
Le Palais a été édifié au milieu du XVIIe siècle, pour les Lascaris-Vintimille que Charles Emmanuel II, Duc de Savoie, considérait comme la « principalissima » des familles de la noblesse niçoise, et en perpétue la renommée. Il demeura la propriété de cette famille jusqu’à la Révolution. Mis en vente en 1802, il subit d’importantes dégradations. Racheté en 1942 par la ville de Nice, il fit l’objet d’un classement au titre des monuments historiques en 1946.
Des travaux de réhabilitation débutèrent en 1963 et s’achevèrent en 1970, année de l’ouverture définitive du palais au public, en tant que musée municipal. Il constitue, avec la douzaine d’édifices religieux situés dans son proche voisinage, un ensemble exceptionnel qui décline toutes les phases successives de l’évolution de l’architecture baroque du début du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle.
À la découverte du Palais Lascaris
Les livrets de visite À la découverte du Palais Lascaris illustrés par Coun sont disponibles en quatre langues (français, niçois, italien et anglais). Vous pouvez les obtenir à l’accueil du Palais.
Le palais a été édifié à partir de 1648 pour Jean-Baptiste Lascaris (1600-1650), seigneur de Castellar, maréchal de camp du duc de Savoie, descendant des comtes de Vintimille.
Son ancêtre, Guillaume-Pierre de Vintimille avait épousé en 1261 Eudoxie Lascaris, princesse de la dynastie byzantine, qui régna sur l’empire de Nicée après la prise de Constantinople par les Croisés. Les comtes de Tendes et d’autres lignées des Vintimille, issus de cette union, adoptèrent le nom et les armes des Lascaris.
La famille des Lascaris-Vintimille, toutes branches confondues, a compté de nombreux chevaliers et dignitaires de l’Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, plus connu sous le nom d’Ordre de Malte.
Façade ouest
La façade ouest, qui ne présente pas les qualités monumentales et décoratives de la façade principale ne parvient pas à occulter la conception assez complexe du bâtiment, des structures préexistantes ayant été conservées, adaptées et englobées dans la construction du XVIIe siècle. Les architectes se sont surtout efforcés de masquer le cloisonnement des espaces intérieurs et les disparités de l’ensemble, par la création d’un cadre plus prestigieux constitué par la façade principale, le vestibule d’entrée et la cage d’escalier.
Pour les informations de la « visite guidée », voire guide « le palais Lasacris », 2007, collection Patrimoine – Direction de la culture, rédacteur Charles Astro.
Façade principale
La façade principale du palais épouse la courbe de la rue Droite, jadis artère principale de la cité. Elle souffre de l’absence de dégagement, mais se détache nettement par son caractère solennel et son opulence, des façades plus modestes qui l’entourent. Sa composition reflète l’ordonnance intérieure du bâtiment et son élévation, en privilégiant le portail de marbre de l’entrée principale au rez-de-chaussée et au troisième niveau, l’enfilade des hautes fenêtres de « l’étage noble », richement décorées de stucs et précédées de balcons à balustres de marbre blanc.
L’usage des masques grimaçant qui ornent les consoles sculptées de ces balcons ainsi que les encadrements des baies rappellent plusieurs façades de palais génois de la même époque. La façade du palais Lascaris dont la qualité exceptionnelle pour Nice et le sud-est de la France doit être soulignée, paraît avoir été achevée à la fin du XVIIe siècle ou au début du XVIIIe siècle et est assez représentative de l’influence du style baroque tardif que l’on rencontre dans l’architecture aristocratique de l’Italie du Nord, en particulier à Gênes et Turin.
Le vestibule et l’escalier
Le palais Lascaris se compose de deux grands corps de bâtiments asymétriques et parallèles, de cinq niveaux chacun, séparés par la cage d’escalier et par les deux petites cours intérieures sur lesquelles celui-ci s’éclaire par de grandes arcades et baies cintrées.
L’ensemble composé par le vestibule d’entrée et l’escalier d’honneur qui le prolonge avec un bel effet de scénographie, est l’une des plus belles réussites de l’architecture baroque niçoise, en même temps que l’une des principes illustrations de l’influence artistique génoise dans le Pays de Nice au XVIIe siècle.
Le vestibule, de plan quadrangulaire, est couvert par une voûte surbaissée, à pénétrations, ornée de vigoureux motifs ornementaux de style baroque, peints à la fresque. Les feuilles d’acanthe, masques et cuirs se déploient dans des tons de grisaille sur un fond ocre rouge, autour d’un grand cartouche figurant les armoiries de la famille Lascaris-Vintimille avec leur devis « nec me fulgura » (la foudre même ne m’atteint pas).
Cette décoration, qui recouvrait également les murs à l’origine a été réalisé par des artistes anonymes de l’Ecole Génoise vers la fin du XVIIe siècle ou le début du XVIIIe siècle, époque de l’achèvement de l’escalier. Les mêmes ornements se retrouvent sur les voûtes d’arêtes de la cage d’escalier, encadrant les grands médaillons allégoriques de la Victoire (1er étage) et de la Renommée (2ème étage).
La totalité des décors peints, qui avaient été en grande partie dégagées des badigeons qui les recouvraient en 1965-1966, a été l’objet de récents travaux de restauration et de réhabilitation entre 1996 et 2001.
L’escalier est agrémenté de balustres sculptées et de statues de marbre (Mars, Vénus, buste de Bacchus enfant et bustes « à l’antique » d’ancêtres impériaux de la famille des Lascaris-Vintimille).
Les statues comme les bustes ont été placés dans des niches encadrées d’ornements en stuc de style rococo, réalisés en 1766, lors d’une restauration rappelée par l’inscription insérée au-dessus de l’arc de la voûte de l’escalier d’honneur.
Les salles du 1er étage
Le premier étage du palais est occupé par des salles aux plafonds surbaissés, semblables aux « mezzanini » des palais italiens. Au XVIIIe siècle, il abritait des appartements privés habités par des membres de la famille du comte Lascaris. Ces salles nous sont parvenues dépourvues de décoration. Elles sont actuellement utilisées pour la présentation des expositions temporaires, notamment :
- 2013 : “Matisse. Les années Jazz” dans le cadre de l’évènement « Nice 2013, un été pour Matisse»
- 2014 : “Art et Musique, XVIIe et XVIIIe, dans les collections du musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon”
- 2015 : “Les Fêtes d’Art, Nice, Hôtel Ruhl, 1924-1926”, dans le cadre de l’évènement « Nice, PromenadeS des Anglais »
- 2016 : “Bâton de pluie, tambour lunaire. Instruments d’Orient, d’Afrique et d’Asie”
L’étage noble et les appartements d’Apparat
Comme dans la plupart des palais aristocratiques génois, les appartements de représentation ont été aménagés au second étage, « étage noble » ou « bel étage », de part et d’autre de l’escalier. Les salles composant ces appartements conservent leurs décors plafonnants d’origine, à thèmes mythologiques, réalisés au milieu et dans la seconde moitié du XVIIe siècle, par des peintres de l’École génoise et des stucateurs lombards.
L’ensemble des salles fut remis au goût du jour par le comte Jean—Paul-Augustin Lascaris autour de 1766. De ces aménagements subsistent encore les boiseries des portes et de la Chambre des Saisons qui dénotent l’influence du style rococo. Après l’achèvement des travaux de restauration, les salons ont retrouvé un ameublement d’époque provenant des collections des Musées de Nice, de donations et d’acquisitions plus récentes grâce à l’aide du Fonds Régional d’Acquisition des Musées. Des cheminées du XVIIIe siècle, très endommagées, n’ont pu être remontées.
Les salles constituant les appartements d’apparat sont réparties dans les deux ailes du palais :
- A l’est, l’appartement dont les salons en enfilade donnent sur la rue Droite
- A l’ouest, l’appartement de l’aile de la chapelle, qui s’éclaire en partie sur les « puits de lumière » des deux petites cours intérieures, mais dont les petits salons, disposés également en enfilade ouvrent sur l’ancienne rue de la Juiverie, actuellement rue Benoît Bunico.
Appartement donnant sur la rue Droite
Grand Salon dit de Phaéton

Ce salon, le plus important du palais, possède un plafond peint à la fresque vers la fin du XVIIe siècle. Il figure « la Chute de Phaéton foudroyé par Jupiter ». Cet épisode mythologique, très fréquemment représenté dans les résidences de l’aristocratie ligure dont les familles se considéraient descendantes de ce malheureux héros, est traité avec une expression vigoureuse et dramatique. Il est mis en scène « à ciel ouvert », dans une illusion d’espace et de volume. Il est encadré par une frise de thèmes architecturaux en trompe-l’œil, agrémentée de figures de « putti » et « d’ignudi » peints en grisaille, de médaillons et guirlandes à rehauts d’or, dans la grande tradition décorative baroque romaine, inaugurée au palais Farnèse avec les Carrache. Les attributions de ce plafond à Giovanni Battista Carlone, de Gênes, ou à son compatriote Giovani Battista Merano ont été remises en cause, amis l’on s’accorde pour reconnaître l’œuvre d’artistes génois de la seconde moitié du XVIIe siècle.
Le grand salon comme les salles voisines conserve ses portes « volantes » à l’italienne, du XVIIIe siècle, dont le vantail unique est fixé par des paumelles dissymétriques, selon l’usage très répandu en Italie du nord comme à Nice. Ce système permettait à la fois d’alléger son poids, de réduire les vents coulis et d’éviter l’usure des tapis disposé sur le sol. Les peintures originelles des dessus-de-porte, disparues à la Révolution, ont été remplacées en 2002, grâce à l’acquisition par le musée d’une série de toiles figurant des « marines » ou « ports méditerranées imaginaires » datant d’environ 1760-1770, attribués au peintre décorateur lombard Pietro Antoniani. Cette série de peintures provient d’un ancien palais aristocratique du Vieux-Nice dans lequel elles remplissaient la même fonction.
Les murs du salon sont ornés de trois pièces de la tenture de l’Histoire des Amours d’Antoine et de Cléopâtre, des ateliers d’Aubusson et dont les modèles sont attribués au peintre parisien Isaac Moillon (vers 1640-1650).
Régulièrement, ce salon accueille des conférences et des concerts.
Salon ou antichambre de Vénus et Adonis

Au plafond sont figurés la déesse Vénus et son amant le jeune Adonis, emportés dans un char d’or conduit par Mercure. Leur histoire tragique est complétée par les deux médaillons peints en camaïeu de rouge (ou monochromes) insérés dans une frise architecturale en trompe-l’œil rehaussée de guirlandes fleuries et de rubans. Diverses divinités mythologiques y apparaissent : Bacchus, Flore, Amour et Psyché…
Ce plafond, réalisé par un artiste de l’Ecole Génoise rappelle certains décors de Giovanni-Andrea Carlone conservés dans des palais de Gênes et d’Italie.
Les dessus de portes figurant des « marines » appartiennent à la même série que ceux du salon précédant.
Les portes-torches sculptés (fin XVIIe siècle) proviennent d’Italie du Nord.
La chambre d’apparat

La chambre d’apparat est séparée de son alcôve par une magnifique cloison ajourée de trois arcades, d’un effet très théâtral, réalisée vers 1700, assez comparable aux architectures monumentales que l’on rencontre dans les jardins baroques et nymphées de Gênes et de Ligurie, à la même époque.
Les supports sont rehaussés de statues engainées, désignées sous le nom de « termes », plus communément appelées « Atlantes et Cariatides ». Elles ont été réalisées en stuc comme l’ensemble de la décoration et évoquent les œuvres du sculpteur Pierre Puget qui œuvra à Gênes au XVIIe siècle.
Le plafond à fresque représente Psyché portée par Mercure dans l’Olympe. La profusion d’ornements qui entoure le cartouche central est fréquente dans la peinture décorative génoise de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle.
Autour, des médaillons en camaïeu vert figurent des scènes mythologiques : « L’Enlèvement d’Europe », « Hercule et le lion de Némée », « Andromède », « Diane ou Atlante ».
Les personnages mythologiques porte-torches en bois laqué et doré, disposés dans les angles du salon, sont attribués à l’atelier où à l’entourage de Filippo et Domenico Parodi, sculpteurs à Gênes à la fin du XVIIe et XVIIIe siècles.
Le plafond de l’alcôve, inspiré par les métamorphoses d’Ovide est d’exécution plus modeste. La nymphe Daphné, poursuivie par Apollon et ne voulant céder à ses avances est miraculeusement transformées en laurier. Les médaillons latéraux mettent en scène des jeux d’enfants.
Le lit à baldaquin (vers 1760-1770) conserve ses tentures d’origine, en lampas de soie de Lyon.
Parmi les pièces du mobilier de la chambre, l’on peut distinguer deux pièces sans bordures de la tenture de l’histoire d’Achille réalisée d’après les modèles de Rubens (Flandres, XVIIe siècle); des torchères en bois doré, réalisées au XVIIIe siècle, à Gênes, dans l’entourage des Parodi ; un fauteuil d’apparat du XVIIIe siècle. Ce dernier proviendrait de l’ancien palais des évêques de Nice.
La vitrine baroque italienne (XVIIIe siècle) renferme un plat de parade en faïence italienne de Savone-Albisola à décor armorié en camaïeu de bleu (XVIIe siècle).
Appartement de l’aile Ouest
Antichambre de la chapelle
Cette grande salle qui précède d’une part la chapelle du palais et d’autre part l’enfilade des petits salons ouvrant sur l’ancienne rue de la Juiverie, a subi beaucoup de dégradations au XIXe siècle et a dû être reconstituée dans son état du XVIIe siècle avec un plafond à caissons, jadis en bois. Des vestiges des peintures murales du milieu du XVIIe siècle qui ornaient la partie haute des murs sont encore conservés sur trois côtés. Ce sont des figures allégoriques réintégrées dans le décor en partie complété lors d’une restauration en 1977.
Comme au temps des Lascaris, sur les murs de cette salle sont accrochés divers tableaux des XVIIe et XVIIIe siècles à thèmes bibliques et religieux ou bien des portraits selon les circonstances.
Cette salle présente également une sélection d’instruments du dépôt par l’Institut de France de la Collection d’Instruments de musique Tissier-Grandpierre.
Gisèle Granpierre-Desaux (1896-1988), harpiste, premier prix de harpe au Conservatoire de Paris, amie de Gabriel Fauré, est aussi une styliste réputée.
Epouse de Paul Tissier (1886-1926), architecte et aquarelliste de renom, elle travaille avec lui à la création de célèbres fêtes mondaines, les « Fêtes d’Art », qui prendront place sur la Côte d’Azur de 1924 à 1926. Après le décès de son mari en 1926, Gisèle Tissier, à Paris, continue à s’occuper de son cabinet d’architecture ainsi que de sa propre création en tant que styliste : elle organise aussi de nombreux concerts.
En 1948, elle fait l’acquisition, à Nice, de la villa Beau-Site, au pied du Mont-Boron. Sous le nom de Gisèle Harpa, elle y compose plus de quatre cents pièces musicales. C’est là aussi qu’elle installe sa précieuse collection d’instruments de musique dont les plus anciens datent du début du XVIIe siècle.
A son décès en juillet 1988, Gisèle Tissier-Grandpierre lègue sa collection à l’Institut de France afin qu’elle soit accessible au public. Le 31 janvier 2013, Monsieur Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut de France, et le maire de Nice, signent une convention de dépôt de la collection Tissier-Grandpierre au Palais Lascaris.
Grâce à cette convention, 65 instruments de musique anciens remarquables classés Monuments Historiques en 1988 dont 18 harpes ayant appartenues à Gisèle Tissier-Grandpierre, sont venus rejoindre la collection instrumentale du Palais Lascaris, la deuxième collection publique d’instruments anciens de France.
La chapelle
La chapelle du palais était utilisée par la famille Lascaris pour ses offices privés, mais des mariages aristocratiques et baptêmes y furent aussi célébrés jusque vers 1750. Au-delà de cette date, la chapelle perdit son affectation religieuse et fut transformée en alcôve de chambre à coucher, grâce à l’ouverture d’une communication dans la cloison mitoyenne, face aux fenêtres, refermée en 1968 lors des travaux de restauration.
Le plafond de la chapelle conserve un riche décor de stucs de la fin du XVIIe siècle, rehaussés de dorures restaurées en 1979. Afin de respecter la symétrie et l’harmonie architecturale de ce plafond, certains des voûtains et leurs « oculi » (lucarnes arrondies), sont traités en trompe-l’œil. Au centre, dans un grand cartouche rectangulaire, est représentée une scène allégorique : « La Sagesse défiant le Temps et la Mort ». La Sagesse, figurée par la déesse Athéna-Minerve dont on reconnaît les attributs, casque et bouclier, se tient près de Chronos-Saturne, vieillard ailé tenant le sablier et « l’Ouroboros », serpent qui se mort la queue et symbolise le cycle perpétuel du Temps et de l’Eternité. L’angelot, annonciateur de la mort tenant la faux, domine la composition.
Des boiseries dorées de l’époque baroque, provenant d’églises de la région niçoise permettent d’évoquer l’autel disparu de cette chapelle, dont le mobilier est complété par des reliquaires, des sculptures et peintures des XVIIe et XVIIIe siècles.
Le Palais Lascaris de Nice conserve cinq portraits de personnages de l’Ancien Testament peints sur des panneaux de cuir doré ciselé, légués à la Ville de Nice en avril 1903 et intialement conservés par le Musée des Beaux-arts Jules Chéret de Nice. Les personnages peuvent être identifiés car leur nom est inscrit en haut de chacun des panneaux : Jesabel, Etan, Efer, Asalel et Raquel. Ce sont des œuvres de qualité, rares et énigmatiques. Datant de la fin du XVIe siècle, ce sont les cuirs dorés historiés les plus anciens conservés en France. Ces peintures bibliques formaient vraisemblablement le décor mural d’une pièce ; cette idée est confortée par les noms qui sont tous inscrits à une même hauteur de façon à réaliser un ensemble. On ne dispose que de peu d’éléments pour retracer l’histoire des cinq panneaux de cuir doré du Palais Lascaris. Les seules indications dont on dispose sont celles qui sont consignées dans l’inventaire du musée. Pour chacun des cinq panneaux il est précisé […] « Provenant de l’ancienne Synagogue de Nice ».
Chambre ou salon dit des « Chevaliers de Malte »
Ce petit salon, désigné autrefois sous le nom de « chambre », a perdu son plafond décoré mais conserve comme les salles voisines, de jolies portes dont les boiseries ont été réalisées vers 1760-1770 lors d’un réaménagement des appartements ; leur ornementation illustre nettement l’influence du style rococo avec des motifs décoratifs empreints d’une grande finesse sinueux, déchiquetés et asymétriques…
Le décor des panneaux a été réalisé en plaques de cuivre incrustées dans le bois et argentées à la feuille.
Les dessus-de-portes renferment de gracieux paysages de « marines » ou de « bors de rivières », réalisés à la même époque d’après des œuvres du célèbre peintre des ports, l’avignonnais Joseph Vernet.
Récemment ont été regroupés dans ce salon, des portraits de personnalités niçoises ou provençales qui, comme beaucoup des Lascaris-Vintimille, furent dignitaires de l’Ordre Souverain des Chevaliers Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte, issus des familles de la noblesse niçoise, comme les Cays ou les Del Pozzo.
Le buste en bronze de Jean-Paul Lascaris, Grand-Maître de l’Ordre de Malte est une réplique de celui sculpté par le florentin Vitale Covatti, pour son tombeau de la cathédrale Saint-jean de La Valette (malte), en 1658
Le mobilier de ce salon date de la fin du XVIIIe siècle.
Chambre ou « salon des saisons »
Ce salon, à partir du milieu du XVIIIe siècle, devint une chambre avec son alcôve aménagée en lieu et place de la chapelle, ainsi qu’en témoigne le lambris toujours conservé encadrant depuis 1970 une grande glace à panneaux.
Le plafond, de la fin du XVIIe siècle, a été décoré par les stucateurs des mêmes ateliers lombards qui achevèrent à la même époque les ornements des voûtes des chapelles latérales de la cathédrale Sainte-Réparate.
De grands motifs baroques : volutes, feuilles d’acanthe, guirlandes et rubans entourent des mascarons d’angle et des peintures. Dans le cartouche central est figuré « l’Enlèvement de Ganymède par Jupiter métamorphosé en aigle », dans les médaillons latéraux les quatre saisons sont incarnées par des « putti », enfants jouant avec les attributs de l’Hiver, du Printemps, de l’Eté et de l’Automne.
Sur le lambris de l’alcôve, dont la décoration est identique à celle des portes, sont figurés des motifs et instruments de musique disposés en trophées.
Le coffre, du XVIIe siècle, est orné de laques florentines du XVIe siècle figurant les neuf Muses.
Ce petit salon permet la présentation d’une sélection de harpes tout à fait remarquables du XVIIIe siècle au XXe siècle issues en grande partie de la collection Fondation Gisèle Tissier-Grandpierre-Institut de France, des facteurs Erard, Naderman,…
Cabinet des stucs dit « des caryatides »
L’intérêt de cette petite salle, parfois désignée sous l’appellation de boudoir, vient de l’élégante décoration de son plafond plat, réalisée vers la fin du XVIIe siècle, par les mêmes stucateurs lombards, auteurs du plafond précédent.
Un médaillon circulaire à fond bleu est entouré de figures de caryatides ailées et engrainées, la poitrine barrée par un baudrier, qui occupent les angles en alternance avec de grandes coquilles aplaties.
Les Salles Gautier
Ces deux salles permettent la présentation permanente d’instruments issus de la collection léguée à la Ville de Nice en 1904 par Antoine Gautier.
Antoine Gautier (Nice, 1825- Nice-1904) était le fils Joseph Octave Gautier, riche négociant en bois et de Félicité Rossetti, fille du préfet Ignace Rossetti et petite fille du sénateur. Docteur en droit et musicien, Antoine Gautier jouait du violon et de l’alto et avait formé un quatuor avec son frère Raymond Gautier. Chez lui, rue Papacino à Nice, il accueille dans son salon de musique de fameux musiciens comme les violonistes Jacques Thibaud, Eugène Ysaÿe, ou encore Gabriel Fauré. Sa collection, constituée de 225 instruments venus du monde entier, est la deuxième de France et l’une des plus importantes d’Europe.
Elle est un rare et précieux témoignage des goûts musicaux de la grande bourgeoisie niçoise cultivée au XIXe siècle.
Le musée du palais Lascaris a été créé en 1963 dans l’ancienne demeure baroque de la famille des Lascaris-Vintimille, témoignage majeur de l’architecture civile baroque à Nice.
- Art décoratif et beaux-arts des XVIIe et XVIIIe siècles : tapisseries, peintures, sculptures, mobilier et objets d’art
- Collection instrumentale
- Fonds d’ethnographie régionale
A l’étage noble, les appartements d’apparat invitent à la découverte des plafonds ornés de fresques à thèmes mythologiques ou à ornements de stucs, de la fin du XVIIe siècle.
Le Palais abrite, en outre, une prestigieuse collection d’instruments de musique savante européenne, à savoir le legs Antoine Gautier qui représente la deuxième collection de France (après celle du musée de la Musique à Paris) et l’une des plus importantes d’Europe.
En 2013, le Palais Lascaris a bénéficié du dépôt prestigieux, par l’Institut de France, de la célèbre collection d’instruments de musique réunie par Gisèle Tissier-Grandpierre, célèbre harpiste et amie de Gabriel Fauré.
Le centre de documentation propose un fonds généraliste (histoire, sciences humaines, muséologie) et des fonds spécialisés.
Les fonds
- Histoire de l’art des XVIIe et XVIIIe siècles
- Art baroque
- Histoire de la musique
- Histoire régionale
Le centre de documentation du Palais Lascaris, constitué dès la création du musée, s’est développé au gré des missions successives qui lui ont été confiées. Il est composé d’ouvrages d’histoire de l’art, de l’art décoratif et de l’architecture des XVIIe et XVIIIe siècles, et principalement de l’art baroque. Il conserve aussi des livres et des revues sur le pays niçois, la Provence, le Piémont et la Ligurie (histoire, culture, arts et traditions populaires), Le centre de documentation propose également un important fonds dédié à la musique : revues, articles, catalogues d’exposition, programmes de concerts, partitions anciennes et modernes, photographies, documents sonores, lettres et manuscrits, ouvrages sur les instruments et l’histoire de la musique, notamment sur Nice et sa région.
Ces fonds sont accessibles aux scolaires, aux enseignants aux étudiants et aux chercheurs.
Conditions de consultation
Consultation sur place, renseignements bibliographiques par téléphone, courrier et courriel.
Horaires d’ouverture : mercredi, jeudi et vendredi 10h-12h /14h-16h30, sur rendez-vous.
Contact : 04 93 62 72 41 ou [email protected].
Catalogues consultables en ligne : catalogue en ligne
Catalogue Sudoc : www.abes.sudoc.fr
Visites commentées d’1h30 pour tous les publics sur réservation uniquement.
Contact :
04 93 62 72 41
[email protected]
Tarifs visite guidée :
7 € par personne (en complément du droit d’entrée)
Groupes adultes (14 à 30 personnes) : 85 € (en complément du droit d’entrée)
Gratuit pour les enfants de moins de 13 ans.
Médiations dans le cadre scolaire pour les enfants scolarisés à Nice : grandirenculture.nice.fr
Document de visite pour les enfants sur demande à l’accueil du musée.